
La géopolitique en échecs
Dans les foyers comme dans les chancelleries, les compétitions internationales d’échecs furent longtemps suivies avec autant de passion et d’attention que les Jeux olympiques. Vedettes planétaires nimbées de mystère, les joueurs symbolisaient la puissance cérébrale et l’adresse tactique de leur pays. Moins spectaculaire qu’au temps de la guerre froide, cette reproduction des rapports de forces géopolitiques à l’échelle d’un échiquier se poursuit néanmoins. Avec de nouveaux acteurs...
D’après Garry Kasparov (
Pour qui voit la Terre comme un échiquier, les cases blanches et noires furent ainsi une métaphore de l’affrontement Est-Ouest. Peu après 1945, les armes se taisent à peine que l’antagonisme entre les Etats-Unis et l’Union soviétique scinde le monde en deux blocs. La guerre froide commence, avec ses deux propagandes rivales : « homme libre » contre « homme nouveau ». Mais lequel est le plus intelligent, le plus déterminé, le plus créatif ? Moscou entend répondre à cette question avec le jeu d’échecs.
En 1948, le très communiste Mikhaïl Botvinnik, mûri au feu des batailles menées dans les années 1930, inaugure une longue chaîne de champions du monde soviétiques, puis postsoviétiques, presque ininterrompue jusqu’au sacre de l’Indien Anand en 2008. Presque... car, en 1972, lors d’un match qui fut le plus médiatisé de l’histoire du noble jeu, l’Américain Robert (dit « Bobby ») Fischer défit le tenant du titre, Boris Spassky. Un camouflet d’autant plus cuisant que, quelques jours avant la rencontre, le président américain Richard Nixon avait envoyé au challenger un télégramme d’encouragement « au nom de tous les Américains et du monde libre »... La victoire du génie solitaire Fischer (
Dès septembre 1945, une équipe d’URSS affronte les dix meilleurs représentants des Etats-Unis, qui dominent alors les grandes compétitions internationales. Les joueurs soviétiques, pour la plupart inconnus en dehors de leurs frontières, écrasent leurs adversaires par 15,5 à 4,5. Entre 1952 et 1990, l’URSS remportera les Olympiades, organisées tous les deux ans depuis 1927, dix-huit fois sur dix-neuf participations.
Comment expliquer cette domination ? Derrière l’image d’Epinal d’un « style soviétique », d’une « école soviétique » aux programmes d’entraînement scientifiques, les dirigeants communistes ont surtout su mener une impressionnante politique de popularisation du jeu, pariant qu’une élite de très haut niveau émergerait d’une masse considérable de pratiquants.
Dès les années 1920, le régime finance de gigantesques tournois entre unions syndicales, villes et corps d’armée. Parallèlement, les autorités encouragent la publication, la traduction de livres et de revues spécialisés, ainsi que la diffusion d’émissions de radio relayant sans relâche les derniers résultats nationaux. Pour les esprits les plus brillants, les échecs vont durablement tenir lieu d’occupation à la fois gratifiante intellectuellement et peu dangereuse politiquement (
L’accueil réservé à Erevan aux joueurs arméniens — anciennement soviétiques —, vainqueurs des Olympiades pour la deuxième fois d’affilée en 2008, permet de mesurer l’impact d’un tel effort de popularisation : après leur rapatriement dans l’avion présidentiel, les champions ont été accueillis par des milliers de supporteurs et acclamés à travers toute la ville. Un scénario plutôt improbable pour des joueurs français — d’échecs tout du moins.
En dépit de ces deux victoires de l’Arménie, faisant suite à celles de l’Ukraine et de la Russie, les anciennes républiques soviétiques sont concurrencées depuis les années 2000 par deux pays-continents dotés d’un inépuisable réservoir de joueurs. L’Inde a commencé par profiter de l’éclosion d’un talent hors normes, Anand, avant de mener une politique volontariste. On citera les récompenses de près de 150 000 dollars accordées à Humpy Koneru, en 2001, pour son titre de championne du monde juniors ; à 22 ans, elle pointe maintenant à la deuxième place du classement féminin. Mais, pour bien des observateurs, c’est la Chine qui menace le plus la domination des pays de l’ex-URSS.
Les Chinois ont adopté un principe soviétique : l’émulation par le groupe
En 2005, le Championnat du monde par équipes — compétition quadriennale opposant dix nations — donne d’ailleurs lieu à des péripéties. L’équipe chinoise domine outrageusement le tournoi ; le dernier jour, face à la Russie, elle peut même se permettre une défaite par 3 à1 (5). Le jeune Ni Hua doit, sur le dernier échiquier, obtenir la nulle pour assurer le titre à ses compatriotes. Las, après plus de cinq heures de résistance, il éclate en sanglots et abandonne. Finalement victorieux par 3,5 à 0,5, les Russes remportent la compétition. Mais, lors des Olympiades de 2006, la Chine, deuxième, se placera devant les Etats-Unis (troisièmes) et la Russie (sixième).
De tels résultats, auxquels s’ajoutent ceux des joueuses chinoises (6), permettent de mesurer le travail effectué dans un pays où les échecs furent interdits durant les dix années de la « révolution culturelle ». Pour Valeriy Aveskulov, un grand maître (7) ukrainien habitué à jouer dans les deux pays, c’est la communion entre les joueurs chinois qui les distingue le plus de leurs homologues indiens, et pour tout dire du reste du monde : « Alors que les Indiens donnent le sentiment qu’ils jouent pour eux-mêmes, les Chinois, en plus de travailler très dur, forment une équipe avec un grand “E”. » Les dirigeants chinois ont en effet adopté une valeur-clé du système soviétique : l’émulation par le groupe, paradoxale pour un jeu d’affrontement par nature solitaire et concurrentiel. Dans les académies d’échecs, présentes dans plus de trente villes chinoises, on trouve notamment un dortoir, ce qui permet aux champions de s’immerger pendant plusieurs jours d’affilée dans leur discipline et, surtout, de se fréquenter assidûment. Ces séances d’entraînement en commun préparent notamment les joueurs qui doivent se rendre en groupe aux compétitions organisées à l’étranger.
La domination se joue également à un autre niveau, celui de la légitimité culturelle et historique. Remporter les principales rencontres internationales est une chose ; inscrire ces victoires sur le long terme en est une autre, qui nécessite d’écrire ou de réécrire l’histoire des échecs, ou plutôt leur légende.
En 1991, Anand, alors âgé de 21 ans, participe à l’un de ses premiers grands tournois. Il s’y trouve confronté au mépris des joueurs de l’Est. L’un d’entre eux lui explique qu’il ne deviendra jamais autre chose qu’un « joueur de café », faute d’avoir pu profiter de l’enseignement des entraîneurs soviétiques. Non seulement Anand remporte le tournoi — et bat au passage Kasparov —, mais il donne également un sens à sa victoire en signalant que ce sont les Indiens qui ont inventé les échecs (8). La majorité des historiens considère en effet que le chaturanga, né en Inde à la fin du VIe siècle — puis diffusé, via la Perse et le monde musulman, en Europe, où ses règles actuelles ont pris corps —, est l’ancêtre du jeu pratiqué aujourd’hui.
Certains le contestent. Déjà, en 1961, lorsque deux des meilleurs joueurs d’URSS rédigent un ouvrage à la gloire de l’« école soviétique », ils ne se contentent pas de louer le travail des cadres techniques du régime. Ils soulignent que des fouilles archéologiques menées en Asie centrale — dont on ne trouve trace dans aucune autre source historique — « prouvent » que les échecs seraient nés au Ier siècle de notre ère aux confins de la Russie (9).
Depuis quelques années, une nouvelle théorie est apparue, celle d’une origine... chinoise des échecs. Elle vient à point nommé conforter les adeptes du jeu dans l’empire du Milieu, qui doivent compter avec la concurrence de deux autres jeux de stratégie, le xiangqi et le go. Ils affirment que les échecs « occidentaux » seraient issus d’une version chinoise du jeu, apparue plusieurs siècles avant le chaturanga. Les soixante-quatre cases de l’échiquier ainsi que l’alternance du noir et du blanc attesteraient même… l’influence du Livre des transformations (10) sur l’invention des échecs et, partant, la parenté entre les mécanismes de ce jeu et la « pensée chinoise » (11).
On le voit, la Chine n’a rien à envier à l’URSS. Nazar Firman, un autre grand maître ukrainien, estime que, derrière les meilleurs joueurs actuels de l’empire du Milieu, des dizaines, sinon des centaines d’autres se tiennent prêts. Aveskulov estime pour sa part que la Chine n’a plus guère qu’à attendre l’éclosion d’un ou deux talents hors du commun pour asseoir sa préséance — le travail seul n’y suffisant pas. Et il conclut en souriant : « Le communisme a des avantages, comparé à la démocratie... pour le sport, en tout cas. »
Manouk Borzakian.
(2) Cf. Garry Kasparov, On My Great Predecessors. Part I, Everyman, Londres, 2003.
(3) Fischer se retirera ensuite de la compétition et, en 1975, abandonnera son titre à Anatoli Karpov.
(4) Lire notamment Andrew Soltis, Soviet Chess, 1917-1991, McFarland, Jefferson, Londres, 2000.
(5) Chaque équipe était formée de quatre joueurs. En cas de défaite par 3 à 1 — trois défaites individuelles et une victoire, ou deux défaites et deux parties nulles —, la Chine aurait comptabilisé autant de victoires collectives que la Russie mais un meilleur départage (plus de victoires individuelles).
(6) Xie Jun a été quatre fois championne du monde entre 1991 et 2000 ; son exemple sera suivi par Zhu Chen (2002) et Xu Yuhua (2006). La Chine a remporté les Olympiades féminines en 1998, 2000, 2002 et 2004.
(7) Le plus haut titre de la hiérarchie échiquéenne.
(8) Anand rapporte cette anecdote dans « The Indian Defense », Times.com, 2008.
(9) Alexander Kotov et Mikhaïl Youdovitch, Le Jeu d’échecs en Union soviétique (1961), Editions du Progrès, Paris, 1979.
(10) Ou Yijing, traité chinois d’origine mythique qui décrit le monde à l’aide de soixante-quatre hexagrammes, eux-mêmes constitués de lignes représentant le yin et le yang.
(11) Cf. Liu Wenzhe, The Chinese School of Chess, Batsford, Londres, 2002. L’auteur est le principal artisan du développement des échecs en Chine.




























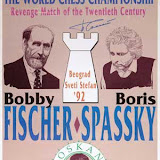




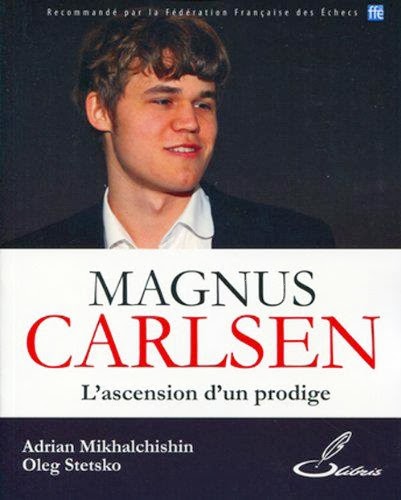





















































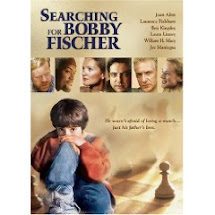















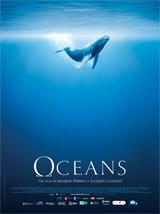




















Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire